Dossier
Nous publions ici (en partie), le chapitre “Les femmes pendant la Commune” tiré de l’ouvrage de Maurice Dommanget, Hommes et choses de la Commune (1). Ce chapitre a été publié en 1923 dans les revues L’École Émancipée et L’Ouvrière. Même si quelques tournures de ce texte paraissent “datées”, l’auteur y souligne pour toutes ces femmes leur courage, leur détermination et la force de leur engagement.
Les inter-titres sont de la rédaction.
Pendant la Commune, les femmes de la classe ouvrière et les quelques bourgeoises pénétrées d’idées féministes et socialistes furent, en général, admirables d’ardeur et de dévouement.
C’est en parlant de la communarde que le correspondant du Times écrivait : “Si la nation française ne se composait que de femmes, quelle terrible nation ce serait”.
Le 18 mars, ce furent des femmes qui décidèrent de la journée en se portant vers les soldats, en les poussant à lever la crosse en l’air et à fraterniser.
Durant toute la Commune, elles se jetèrent en nombre impressionnant dans la fournaise. C’est bien pour quoi les calomnies, les mensonges, les libelles diffamateurs, les légendes absurdes ont été accumulés sur leur compte. Beaucoup plus que les communards, elles ont été salies, flétries, marquées au fer rouge et c’est le signe certain, éclatant de leur participation active à la Révolution du 18 mars.
On les traitait de femelles, de louves, de mégères, de soiffardes, de pillardes, de buveuses de sang. On les montrait se distinguant de bonne heure par leurs “mauvais instincts”, leur “conduite immorale”, leur “détestable réputation”. […]
Les plus en vue, les plus cultivées étaient traitées de “femelles littéraires”, “institutrices déclassées”, “laiderons furibondes”. […]
Dans les clubs et les comités
Au club, dans les salles de rédaction des journaux, à l’hôpital, dans les ambulances et jusque sur les barricades on trouvait des femmes.
Le Club de la Boule Noire comptait une citoyenne dans son bureau et le Club des Prolétaires avait une blanchisseuse comme secrétaire. Au Club de Saint-Eustache, où l’élément féminin était toujours dominant, les citoyennes Brossut, Joséphine Dulimbert et Anne Menans prenaient d’ordinaire la parole.
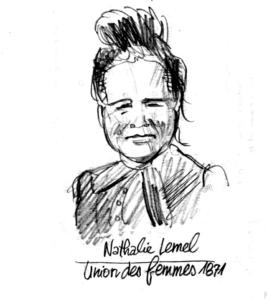
Plusieurs groupements se composaient uniquement de femmes. Tel fut le Comité central de l’Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés ou plus simplement Comité central de l’Union des femmes, placé sous l’inspiration de Nathalie Le Mel et d’Élisabeth Dmitrieff. La première était amie de Varlin et l’une des fondatrices de la Marmite. […]
Le Comité publiait des manifestes et organisait des réunions publiques, dans tous les arrondissements. À la date du 6 mai, il tenait sa dix-huitième réunion publique. Il se proposait de faire fonctionner des fourneaux et des ambulances, de recevoir des dons soit en argent, soit en nature destinés aux blessés, aux veuves et aux orphelins. Il organisait, à cette fin, des permanences dans les mairies. Tout en poursuivant cette besogne d’entre-aide et de solidarité, il n’oubliait pas le travail de revendication, d’éducation et de combat. […]
Les principes qui animaient le Comité étaient ceux de la Révolution sociale et du socialisme le plus radical. Ces femmes acclamaient la “République universelle”, la “rénovation sociale absolue”, “l’anéantissement de tous les rapports juridiques et sociaux existants”, la “suppression de tous les privilèges, de toutes les exploitations, la substitution du règne du travail à celui du capital, en un mot l’affranchissement du travailleur par lui-même”. Elles considéraient Paris comme portant “le drapeau de l’avenir”, voyaient dans la guerre contre Versailles “la lutte gigantesque contre les exploiteurs coalisés” et s’affirmaient convaincues que la Commune représentait les “principes internationaux et révolutionnaires des peuples”.
Tel était aussi l’avis d’un “groupe de citoyennes” qui, à la date du 12 avril, lançait un énergique appel aux “citoyennes de Paris”. On y lit : “Nos ennemis, ce sont les privilégiés de l’ordre social actuel, tous ceux qui ont toujours vécus de nos sueurs, qui toujours se sont engraissés de notre misère… L’heure décisive est arrivée. Il faut que c’en soit fait du vieux monde ! Nous voulons être libres !” .[…]
Le Comité de vigilance des citoyennes de Montmartre, avec Louise Michel, André Léo, Paule Minck, créa un corps d’ambulancières, demanda la disparition des prostituées sur la voie publique et l’élimination des religieuses dans les hôpitaux et prisons. Cette dernière décision est à retenir. En effet, on note en général une tendance anticléricale très vive dans toutes les organisations des femmes de la Commune. Un grand nombre de clubs féminins se tenaient du reste dans des églises dont le maître-autel était décoré d’un drapeau rouge et dont la chaire servait de tribune.
Dans la presse et dans les commissions sur le travail des femmes
Dans la presse rouge, les femmes jouèrent un rôle aussi. Les unes en qualité de correspondantes, comme la citoyenne Dauthier, signalaient les oublis, les abus et poussaient à la lutte la “vieille branche” de Père Duchêne en un style direct, nettement faubourien. D’autres, qui avaient des lettres, mirent leur talent au service de la Commune. Telles furent la citoyenne Reidenhreth, d’origine autrichienne, qui collabora au Populaire, et la citoyenne André Léo qui devint par la suite la femme de Benoît Malon. […]
Au ministère des Travaux publics fonctionnait, avec des syndicats ouvriers, une commission pour le travail des femmes. Les citoyennes qui en faisaient partie portaient une écharpe rouge marquée à ses extrémités de l’estampille du ministère. […]
Sur les barricades et jusqu’au bout
C’est que les femmes de la Commune ne s’arrêtaient pas à mi-chemin. Elles entendaient servir la Révolution les armes à la main. […]
Le 12 avril, l’appel d’un “groupe de citoyennes” dont j’ai parlé plus haut se terminait en exhortant les femmes à “prendre une part active à la lutte engagée”. Il déclarait : “Préparons-nous à défendre et à venger nos frères ! Aux portes de Paris, sur les barricades, dans les faubourgs, n’importe ! Soyons prêtes au moment donné à joindre nos efforts aux leurs… Et si les armes et les baïonnettes sont toutes utilisées par nos frères, il nous restera encore des pavés pour écraser les traîtres !” […]
Tant au cours de la semaine de mai que durant la quinzaine qui suivit il n’y eut point de quartier pour les femmes du peuple ayant le malheur de se buter à la soldatesque versaillaise. Mais le courage de ces femmes fut admirable.
Une partie du tableau de Jules Riou n’illustre que trop bien ces affirmations. On voit quatre communards qui vont être fusillés et parmi eux une femme. Elle montre le poing, narguant les soldats du peloton d’exécution et semblant leur crier : “Allez-y ! Quand vous voudrez !”.

Maximilien Luce, dans ses dessins-souvenirs de la semaine sanglante, représente une rue de Paris jonchée de cadavres. Au premier plan, on voit une femme allongée mais qui lève encore le poing droit, en une attitude énergique. […]
On frappa au ventre des femmes enceintes, on ouvrit le ventre d’autres femmes dont on étala les entrailles sur le trottoir, on souilla d’infortunées jeunes filles, traitées aimablement de “putains”, on fusilla des mères avec leur bébé.
À Montmartre, rue des Rosiers, une femme mourut un enfant dans les bras, refusant de s’agenouiller et criant à ses compagnons : “Montrez à ces misérables que vous savez mourir debout !”.
Toute femme suspecte était fouillée et si on avait le malheur de découvrir sur elle une allumette, un rat-de-cave, une bouteille quelconque son compte était bon. Elle était cataloguée comme “pétroleuse”, injuriée et fusillée. On estime à plusieurs centaines les femmes innocentes qui périrent ainsi assassinées.
Face à la répression
L’arrivée des convois de prisonnières à Satory et à Versailles, le séjour des femmes à la prison des Chantiers, les attaques ignobles dont elles furent l’objet par des “dames distinguées” et des “hommes du monde” ont fait l’objet de descriptions poignantes. Il faut les relire dans Lissagaray, dans Louise Michel ou Edmond Lepelletier pour se faire une idée du “courage” et du “sadisme” des lâches après le danger. […]
Devant les Conseils de guerre et plus tard dans les maisons centrales, sur les pontons comme à Cayenne et en Nouvelle-Calédonie, la plupart des communardes furent indomptables. Cent-cinquante-sept femmes furent condamnées à des peines diverses dont huit à la peine de mort. Un goujat qui présidait le 4e Conseil de guerre, le colonel Boisdenemetz, correspondant du Figaro, criait cyniquement, entre deux audiences dans un café : “À mort toutes ces gueuses !”. C’est dans les conditions les plus scandaleuses, contrairement aux affirmations du garde des Sceaux, Dufaure, que ces procès se déroulèrent ou plutôt s’expédièrent.
Le prolétariat peut être fier de la fière attitude de Louise Michel devant les jurés bottés. La “fille Louise Michel”, la “nouvelle Théroigne”, la “mère Michel” – comme l’appelaient méchamment les porte-plumes de M. Thiers, brava froidement la “Justice”. “Je ne veux pas me défendre, je ne veux pas être défendue ; j’appartiens tout entière à la révolution sociale et je déclare accepter la responsabilité de tous mes actes ; je l’accepte sans restriction […] Si vous n’êtes pas des lâches, tuez-moi”. Les “juges” se montrèrent des lâches et Louise fut condamnée à la déportation.
Il en fut de même d’Augustine Chiffon, que Lissagaray se borne à nommer quand il évoque “quelles femmes terribles sont les Parisiennes même vaincues, même enchaînées”. Félix Pyat considère Augustine Chiffon, cette ouvrière de Belleville, comme “la plus héroïque” de toutes les femmes de la Commune. C’est, à ses yeux, une Louise Michel “plus obscure, plus inconnue, non lettrée, plus peuple, plus brave encore dont le nom plébéien même a nui à sa gloire”. À ses juges en képis, elle dit avant l’arrêt : “Je vous défie de me condamner à mort ; vous êtes trop lâches pour me tuer”. Et après, elle ajouta : “N’ayant pas le cœur de me tuer, vous me torturez, vous me condamnez à vingt ans de bagne ; soit je suis assez jeune encore pour survivre à ma peine et voir enfin le jour de la justice”.[…]
Karl Marx n’avait-il pas raison quand il écrivait que pendant la Commune et grâce à elle “les vraies femmes de Paris avaient reparu à la surface, héroïques, nobles et dévouées comme les femmes de l’antiquité” ? Et ne peut-on pas dire sans exagération que jamais mouvement révolutionnaire ne rallia dans la capitale un aussi grand nombre de citoyennes et ne suscita autant de dévouement féminin ?
C’est la preuve que la Commune sortait des entrailles du prolétariat parisien.
Maurice Dommanget
(1) Maurice Dommanget, Hommes et choses de la Commune, réédition en fac-similé L’École Émancipée et Ivan Davy, 2000, 260 p.
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.